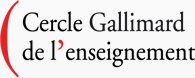Explorer le catalogue Gallimard Jeunesse par thèmes
- Animaux
- -
- Antiquité
- -
- Aventure
- -
- Conte
- -
- Environnement
- -
- Fable
- -
- Jeu de mots
- -
- Merveilleux
- -
- Moyen Âge
- -
- Roman policier
Dossiers thématiques

La Grande Guerre
A l'école élémentaire, la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale trouve toute sa place au cycle 3, où le programme d'histoire couvre les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle, tandis que celui de français «vise à donner à chaque élève un répertoire de références appropriées à son âge, puisées dans le patrimoine et dans la littérature de jeunesse d’hier et d’aujourd’hui».
Pour transmettre l'histoire et les mémoires de la Grande Guerre, découvrez notre sélection d'ouvrages, ainsi que trois propositions de séances : l'une en littérature, autour du roman de Paule du Bouchet, Le Journal d'Adèle, les deux suivantes en histoire, à partir de deux albums documentaires, La Première Guerre mondiale et Le journal d'un poilu.
Voir aussi
- Dossier
- Bibliographie (8)
Au sommaire : Littérature - Histoire
Littérature
Zoom sur...
|
|
Le journal d'Adèle, de Paul du Bouchet (Folio Junior et Écoutez lire)
Août 1914. Adèle a treize ans et demi, bientôt quatorze. Elle commence enfin le journal qu'elle a reçu pour Noël et lui confie les rêves qu'elle a dans la tête : devenir institutrice par exemple, épouser un garçon de la ville. Mais la guerre est là. Cette fois, c'est sûr, on va regagner l'Alsace et la Lorraine. Et elle sera courte, cette guerre. Les deux frères d'Adèle reviendront pour les vendanges, au pire pour Noël. Mais la guerre s'enlise, s'enterre dans les tranchées. La guerre tue, mutile les soldats, affame les gens de «l'arrière», endeuille les campagnes : quatre années de froid, de boue, de sang. En savoir plus : sur l'édition Folio Junior - sur l'édition Écoutez lire |
Proposition de séance
→ Supports de travail : extraits du Journal d’Adèle en Folio Junior et du CD Écoutez lire.
→ Objectifs : aller vers une compréhension de l’implicite ; repérer les sentiments évoqués ou décrits dans un journal intime ; comprendre l’évolution de l’auteur et celle des personnages décrits dans ce contexte historique.
Remarques grammaticales à développer en activité décrochée : repérer les phrases nominales et les phrases courtes sans sujet explicite et comprendre leur rôle dans ce type d’écrit. (ex : dimanche 27/09/14 : « cousu, cousu tout l’après-midi avec Arlette et Louise qui se languit de Paul […] ».
|
Année |
Pagination et entrées du Journal en Folio Junior |
Correspondance sur le CD Écoutez lire |
|
1914 |
p.6 : 30 juillet 1914 |
CD 1 - Piste 1 - du début jusqu'à 01:52 |
|
1915 |
p. 55-57 : du 15 septembre au 8 octobre |
CD 1 - Piste 2 - de 20:04 à la fin |
|
1916 |
p. 70-73 : du 28 août au 20 septembre |
CD 1 - Piste 3 - de 06:45 à 11:23 |
|
1917 |
p. 104-106 : du 16 au 18 juillet |
CD 2 - Piste 2 - de 17:00 à 18:47 |
|
1918 |
p. 126-131 : du 21 juillet au 3 août |
CD 2 - Piste 3 - de 08:47 à 13:42 |
Selon le temps on dispose et le niveau de la classe, on pourra distribuer les passages par groupes ou lire en totalité en groupe-classe tous les passages.
I. A partir des extraits audio
→ Support : piste 1 du CD 1 Écoutez lire
→ Objectifs : reformuler une histoire entendue ; préparer la lecture autonome d'un texte littéraire
1. Extrait n°1 : le 30 juillet 1914 (du début de la piste 1 du CD 1, jusqu'à 01:52)
- Que sait-on d'Adèle et de sa famille ?
- Pourquoi Adèle commence-t-elle son journal précisément en cette fin du mois de juillet 1914, alors que sa marraine lui a offert ce cahier à Noël ?
2. Extrait n°2 : du 22 au 29 septembre 1914 (piste 1 du CD 1, de 21:10 à 23:00)
- Quand ont lieu les vendanges ?
- Adèle dit : « cette sale guerre va donc durer jusqu’à Noël ! ». Qu’espérait-elle, comme toute sa famille ?
- Qu’est-ce qui frappe le plus Adèle quand elle apprend la mort de son voisin Clément ?
- Au marché de Sombernon, ce n’est pas comme d’habitude. Qu’est-ce qui a changé ?
- Que signifie «réquisitionner» ? Pourquoi Adèle précise-t-elle qu’ils étaient «au moins dix entassés dans la charrette»
- Dans sa lettre, le deuxième frère de Paul précise lui aussi qu’il ne sera pas là pour les vendanges. Pourquoi est-ce important ?
- Que sait-on maintenant sur le métier des parents d’Adèle ?
II. A partir du texte
→ Support : pages 26-28, 55-57, 70-73 et 104-106.
→ Objectifs : comparer les extraits de la version audio et ceux du texte du Journal. (cf. compétences « repérer les principaux éléments d’un texte » et « Pour présenter un récit, en choisir un extrait caractéristique et justifier son choix ».)
1. Pages 26 à 28 : du 22 au 29 septembre 1914
A lire seul. Repérer les passages omis par la version audio. Mise en commun. En cas de désaccord, vérifier en réécoutant le passage.
- Le choix de l’éditeur dans la version audio permet-il d’avoir l’essentiel de ce que raconte Adèle ?
- Qu’apportent les passages supplémentaires lus dans le texte ? Lister les informations recueillies. Discuter.
2. Pages 55 à 57 : du 15 septembre au 8 octobre 1915 > La vie à l'arrière, à la campagne - Paul revient
Travail collectif : faire lire à haute voix l’entrée du 15 septembre. Faire réagir sur le style : les élèves auront-ils remarqué la répétition de « parce que » ? Qu’apporte cette répétition voulue, contrairement aux consignes d’écriture habituelles ? Faire expliquer les commentaires « Et c’est nous qui sommes punis ! » et « Il ne manquait plus que ça ! ».
Lecture à haute voix du 21 septembre : le père n’avait pas été mobilisé en 1914 parce qu’il avait 45 ans. Conclure collectivement sur ce qui s’est passé pour que le père soit parti à la guerre.
Travail individuel : lecture silencieuse des entrées du 24 septembre et des 2 et 8 octobre.
Dans ces trois petits textes on constate le bouleversement de la vie des trois aînés de la famille. Relevez une phrase dans chaque qui à votre avis montre le plus ce bouleversement.
→ Mise en commun.
3. Pages 70 à 73 : du 28 août au 20 septembre 1916 > Le retour du guerrier
Attention : s’arrêter au bas de la page 73 (ou à la minute 11:23 du CD 1). La suite de cette entrée est sans doute trop dure pour les élèves de CM2.
Travail collectif : lecture magistrale ou écoute du CD (CD 1, piste 3, de 06:45 à 11:23)
En relisant ce récit d’Adèle, établir ensemble un tableau en deux colonnes des attitudes de la famille et de Paul, pour saisir la frontière entre les deux, infranchissable plusieurs jours durant.
Comparer avec ce que disait Adèle de son frère au moment de son départ (p.9) et après la réception de l'une de ses premières lettres (p.37).
4. Pages 104 à 106 : du 16 au 18 juillet 1917 > la vie à l’arrière, en ville (CD2, piste 2, de 17:00 à 18:47)
Adèle va voir sa tante Berthe à Dijon : elle ramènera à la campagne son jeune cousin de santé fragile.
Lecture silencieuse du passage. Rédaction courte : faire résumer individuellement en quelques phrases les conditions de vie des habitants des villes en cette troisième année de guerre. Confronter les résumés en petits groupes puis en classe entière. Relire éventuellement certains paragraphes pour justifier les écrits.
5. Pages 126 à 131 : du 21 juillet au 3 août 1918 > Adèle a bientôt 18 ans. La vie continue avec ses promesses (CD2, piste 3, de 08:47 à 13:42)
Pourquoi est-ce important d’avoir les souvenirs de jeunes de cette époque ?
|
|
|
|
A lire également
|
|
Le secret de grand-père, de Michael Morpurgo (Folio Cadet Premiers romans) Les parents du narrateur n'ont jamais aimé la vie à la campagne. Lui adore aller dans la vieille ferme de son grand-père. Il aime écouter Grand-Père parler de son enfance de petit paysan : il parle de son père et de Joey, le cheval que celui-ci a sauvé de la mort pendant la Première Guerre mondiale. Un jour, le vieil homme avoue qu'il est analphabète et le garçon lui apprend alors à lire et à écrire. Pour le remercier, Grand-père lui écrit une nouvelle histoire de son père et de son fameux cheval Joey. C'est aussi l'histoire du vieux tracteur remisé au fond de la grange… Télécharger la fiche pédagogique
|
En savoir plus : sur l'édition Folio Cadet - sur l'édition Écoutez lire
Intérêt pédagogique :
La construction narrative du roman permet un travail très intéressant de repérage des narrateurs et des périodes racontées. On rencontre trois générations et plusieurs flashbacks, ainsi que l’enchâssement de l’autobiographie du grand-père dans le récit du petit-fils. On pourra élaborer deux outils collectifs facilitant l’appropriation : un arbre généalogique et une frise chronologique.
Le lien fort entre le grand-père et le petit-fils permet d'aborder la Première Guerre mondiale d'une façon à la fois sensible et distanciée, par le récit dans le récit.
Pour plus d'informations sur l'étude de ce roman au cycle 3, télécharger la fiche pédagogique.
Mise en réseau possible avec Cheval de guerre, du même auteur (voir ci-dessous).
|
|
Cheval de guerre, de Michael Morpurgo (Folio Junior et Écoutez lire) Dans ce roman « autobiographique », c'est Joey, un cheval, qui raconte sa vie. A l'été 1914, il se retrouve embarqué dans la Grande Guerre. Il sera tour à tour monture d’officiers de cavalerie, cheval de trait des ambulances militaires, puis chargé avec des compagnons d’infortune de tirer des canons dans les dédales des tranchées. Joey écoute les cavaliers, les soldats, raconte ce qu’il voit et éprouve. Il se retrouve tour à tour dans les deux camps de part et d’autre du front des tranchées, mais pour lui, les humains sont des humains, quel que soit leur camp.
|
En savoir plus : sur l'édition Folio Junior - sur l'édition Écoutez lire
Intérêt pédagogique :
Les enfants peuvent s’identifier au personnage et entrer dans l’évocation de la guerre des tranchées tout en gardant une certaine distance émotionnelle grâce au choix d’un narrateur animal.
Une autre originalité importante dans ce roman : Joey se trouvant des deux côtés du front au cours de son récit, l’absurdité de la guerre et la dureté des hommes est présente dans les deux camps. Le lecteur rencontre aussi, grâce au cheval, la bonté et la simplicité de certains êtres humains, qu’ils soient français ou allemands.
Le langage élaboré de Michael Morpurgo donnera lieu à d’intéressantes séances de compréhension grâce au contexte et à la confrontation des représentations des situations racontées.
Les illustrations de François Place, à la fois douces et précises, soutiennent bien la compréhension. On pourra faire retrouver aux élèves les passages précis évoqués par les illustrations.
On peut avec profit faire écouter un ou plusieurs extraits du CD Écoutez lire, en introduction ou en renforcement de la compréhension du texte sur support papier.
|
|
Il s'appelait... le Soldat inconnu, d'Arthur Ténor (Folio Junior) Quand il était petit, François rêvait d'être soldat. Puis la guerre de 1914 a éclaté et il est parti se battre, la «fleur au fusil», fier de défendre son pays. Mais il a rapidement découvert la dure réalité des champs de bataille, l'horreur des tranchées, la sauvagerie des hommes. Il a surtout connu une fin tragique, comme de nombreux soldats, et son nom s'est perdu dans la boue de Verdun. C'est ainsi qu'il est devenu... le Soldat inconnu. |
Intérêt pédagogique :
La première partie du récit, qui suit l’évolution du jeune François, rend bien compte de la culture de guerre et du patriotisme de l’époque. A partir de la mobilisation du héros en 1915, le roman plonge le lecteur en première ligne. De ce fait, ce livre est à lire en prolongement d’un travail sur ce sujet.
Histoire
Zoom sur...
|
|
La Première Guerre mondiale, de Simon Adams (Les Yeux de la Découverte) Ce documentaire traite de la Première Guerre mondiale d’une façon à la fois chronologique et thématique. Il retrace l'histoire du premier conflit mondial, abondamment illustrée par des photos d'époque, des documents et des objets conservés : la vie dans les tranchées, les patrouilles, les bombardements, les blessés.... La vision internationale est présente. Un supplément documentaire, en plus du sommaire, du glossaire et de l’index, apporte des informations étonnantes, une chronologie des événements et une liste de lieux commémoratifs et de sites Web. |
Intérêt pédagogique et lien avec les programmes :
On pourra avoir recours à cette très belle encyclopédie documentaire en appui aux lectures de littérature citées plus haut. En référence au pilier 5 du socle commun (les Humanités), le va-et-vient entre les récits (romans ou journaux) et la richesse iconographique du documentaire sera très profitable aux élèves en séance d’histoire (voir ci-dessous).
Proposition de séance
On partira de l’étude du Journal d’Adèle en littérature (voir ci-dessus) pour affiner, en histoire, la recherche et la lecture de documents avec La Première Guerre Mondiale, dans la collection Les Yeux de la Découverte.
Les élèves découvriront ou reliront certains passages du Journal d'Adèle et chercheront, d’une part dans leurs manuels, d’autre part dans le sommaire du documentaire, les documents se référant aux sujets abordés par Adèle.
Notes :
On peut faire le même type de travail à partir d’un des autres journaux cités dans ce dossier, ou d’un roman. La structure des journaux s’y prête particulièrement bien.
Dans le cas d’un travail de groupes, on peut utiliser en complément le journal de Rose, Pendant la Grande Guerre, et sa partie documentaire. La synthèse complète sur les différents thèmes travaillés par les groupes pourra être prolongée au cours d’une deuxième séance.
Déroulement
Relire par groupes, dans Le journal d’Adèle, les passages suivants :
- p. 26 : la lettre d’Eugène («il ne sera pas là aux vendanges, mais peut-être à Noël»).
- p. 51 : le récit des tranchées par Paul. Lire aussi, dans Cheval de guerre, p. 137 à 150 : Joey piégé dans le no man’s land.
- p. 56 : le père d’Adèle est parti lui aussi à la guerre.
- p. 73 : Paul commence à raconter la bataille de Verdun.
- p. 126 : Julien a été gazé.
- p. 127 : Adèle visite l’hôpital des blessés de guerre à Dijon.
- p. 129 : Adèle assiste à l’arrivée des Américains à Dijon.
Pour chaque passage, rechercher dans le sommaire du documentaire d’abord, puis dans les textes et les images, les précisions historiques apportées par les documents et leurs commentaires. Noter les pages explorées et sélectionner un ou plusieurs documents particulièrement parlants. Justifier.
Pour l’enseignant : correspondance entre le journal et le documentaire :
|
Dans Le journal d’Adèle |
Dans La Première Guerre mondiale (Yeux de la Découverte) |
|
p.26 : la lettre d’Eugène et la durée prévisible de la guerre. |
p. 10-11 : les opérations à l’ouest |
|
p. 51 : le récit des tranchées par Paul. |
p. 16-17 : la construction des tranchées |
|
p.56 : le père est parti lui aussi à la guerre. |
p. 12-13 les soldats et les réservistes |
|
p.73 : la bataille de Verdun. |
p. 42-43 : la bataille de Verdun. |
|
p. 126 : Julien a été gazé. |
p. 44-45 : le gaz, arme chimique |
|
p. 127 : Adèle visite l’hôpital des blessés de guerre à Dijon. |
p. 30 : les blessés. |
|
p. 129 : Adèle assiste à l’arrivée des Américains à Dijon. |
p. 54-55 : les États-Unis entrent en guerre. |
|
|
|
|
Zoom sur...
|
|
Le journal d'un poilu, de Sandrine Mirza
À partir des documents légués par son arrière-grand-père, Sandrine Mirza retrace la vie d’un poilu En savoir plus - Feuilleter quelques pages - Lire l'interview de Sandrine Mirza |
Intérêt pédagogique et lien avec les programmes :
Ce journal apporte sa note originale aux autres titres de ce dossier sur la Grande Guerre. Cette fois, c’est presque trois livres en un : journal authentique, documentaire simple et rigoureux et enfin de précieux fac-similés permettant une mise en mains qui contribuera fortement à la «mémorisation de cette période et de ses caractéristiques majeures» (programmes 2010-2011). Cette combinaison inédite aidera efficacement à rendre l’apprentissage vivant.
D’un contenu très riche, ce livre pourrait permettre de traiter tous les aspects de la guerre de 14-18. A noter que, envoyé dans l’armée d’Orient début 1918, André Beaujouin est allé jusqu’à la frontière de l’Ukraine en avril 19 face aux Bolcheviks, et ne sera démobilisé que le 16 septembre 1919. Les élèves prendront ainsi conscience d’une part que pour de très nombreux soldats français la guerre ne s’est pas terminée le 11 novembre 1918, d’autre part qu’une nouvelle menace était perçue : la Russie soviétique.
Proposition de séance
À partir du journal, utiliser le récit pour caractériser la période et identifier ses repères chronologiques. Prendre conscience à la fois de la violence du début du XXe siècle, des conditions de vie des soldats de la Grande Guerre et des ressources humaines qui les ont aidés à tenir le coup. On complétera les informations données par le journal par la lecture d’éléments documentaires et des fac-similés.
I. Prendre connaissance du journal : les circonstances d’une vie particulière dans les événements de la guerre
L’enseignant présente rapidement le personnage d’André Beaujouin et son journal. Il précise que ce livre a été constitué par son arrière-petite-fille. Pour balayer ensuite l’ensemble du journal sur un temps assez court, on répartit la recherche entre petits groupes de travail. Une synthèse sous forme de tableau collectif réunira ensuite leurs découvertes.
Il est aussi possible d’étaler ce travail sur plusieurs séances, ainsi que de le coupler avec une approche littéraire du genre épistolaire et une lecture approfondie de certains passages.
Note 1 : la numérotation des pages permet de se repérer :
- pages paires : pages du journal et photos ou cartes personnelles.
- pages impaires : pages documentaires
Note 2 : la première série de tableaux (I-1 à II-3) permet à l’enseignant une mise au travail des élèves par groupes, en choisissant sur quel aspect mettre l’accent. La deuxième série de tableaux (II-a à II-c), destinée à l’enseignant, lui permet de cibler les éléments qu’il peut faire relever par les élèves.
Tableaux pour le travail en classe
I-1 – André Beaujouin : sa jeunesse sous les drapeaux
|
Support |
Pages |
Recherche : quel âge a André ? |
|
Le journal
|
4 |
Au début de la guerre |
|
6 |
À sa mobilisation |
|
|
26 |
Lors de sa rencontre avec Antoinette |
|
|
46/48 |
À sa démobilisation |
|
|
48 |
À son mariage |
I-2 – La guerre d’André Beaujouin : les lieux où il a combattu
|
Supports |
Pages |
Recherches : où est André ? |
|
Pages du journal Cartes (fac-similés et pages documentaires) Bulletins de santé |
8 à 13 ; 18 à 19 ; 20 |
André dans les tranchées |
|
10 ; 12 ; 16 ; 20 |
André en déplacement ou à l’arrière |
|
|
12 ; 14 |
André hospitalisé ou en convalescence |
II – Explorer les conditions de vie du soldat André, ses états d’âme et ce qui le soutient
II-1 – La guerre d’André Beaujouin : les conditions de vie et les états d’âme
Faire rechercher dans les différentes pages du journal, appuyées par les parties documentaires et certains fac-similés, les informations sur les conditions de vie très rudes d’André et de ses camarades poilus.
Faire repérer également ce qu’il écrit sur son moral et ce qu’il pense de cette vie de soldat.
|
Supports |
Pages |
Lieux |
|
Pages du journal Pages documentaires Fac-similé de la chanson de Craonne Cartes |
8 à 10 ; 9 |
Sur le front lorrain : Les Éparges |
|
11 à 13 |
En Artois |
|
|
14 et 15 |
En Champagne |
|
|
16 et 17 |
Dans la Marne |
|
|
18 |
Dans la forêt d'Argonne |
|
|
20 |
Vers la Somme |
|
|
22 |
Dans la Somme |
|
|
24 et 25 |
Dans l'Aisne, au Chemin des Dames puis à Craonne |
|
|
30 |
En Ariège, à Pau |
|
|
32 |
Brive |
|
|
36 et 37 |
Tossilovo (près de Salonique et de la Bulgarie) |
|
|
38 à 40 |
Dans les tranchées en Grèce sur le front bulgare |
|
|
42 |
En Bulgarie |
|
|
44 |
Dans les Balkans, beaucoup de déplacements à travers la Roumanie jusqu’au bord de l’Ukraine |
|
|
46 |
Sur le chemin du retour depuis la Bessarabie, puis la Bulgarie, etc. |
II- 2 – La guerre d’André Beaujouin : ce qui le soutient dans l’action ou l’inaction dans son bataillon
De la même façon, faire rechercher ce qui aide le soldat à tenir le coup au sein de l’armée. Comment André en parle-t-il, et quelles informations supplémentaires donnent les documents ?
|
Supports |
Pages |
Lieux |
|
Pages du journal Pages documentaires Fac-similé du journal Le Poilu poilu Déchaîné |
10 |
Les Éparges |
|
14 |
En Champagne |
|
|
16 |
À l'hôpital de Saint-Dizier puis de Lyon |
|
|
22 et 23 |
Dans la Somme |
II- 3 – La guerre d’André Beaujouin : le soutien moral qui vient de l’extérieur
André Beaujouin a été hospitalisé de nombreuses fois (cf. carte) et a été aussi en permission. Il a correspondu très régulièrement avec sa famille et, à partir de 1917, avec Antoinette Creuzet.
Faire repérer comment André parle du soutien que lui ont apporté ces moments et ces courriers si précieux.
|
Supports |
Pages |
Lieux |
|
Pages du journal Pages documentaires Fac-similé de la lettre d'Antoinette Cartes |
14 |
Dans sa famille |
|
20 |
Dans la Brie |
|
|
24 |
Près de Melun (Ponthierry - Montgermon) |
|
|
26 et 27 |
Montgermon |
|
|
28 |
Montgermon |
|
|
30 et 31 |
Pau |
|
|
32 |
Permission à Paris |
|
|
40 |
En Grèce, sur le front bulgare |
|
|
42 et 43 |
En Bulgarie |
Tableaux pour l’enseignant
II-1 – Les conditions de vie et les états d’âme du poilu à travers l’expérience d’André Beaujouin
|
Pages |
Lieux |
Exemples d'éléments à relever |
|
8 et 10 |
Sur le front lorrain : Les Éparges |
Troncs d'arbres déchiquetés à perte de vue, énormes charognes, «poilus terrés comme des lapins dans leur trou», courir au milieu des explosions, membres déchiquetés qui volent, les balles qui sifflent aux oreilles, 4 jours dans une tranchée sans pouvoir bouger. |
|
11 à 13 |
En Artois |
«Une vraie boucherie». Se perdre dans les tranchées allemandes. |
|
14 et 15 |
En Champagne |
Des «gourbis répugnants, pleins de rats», sur la paille. L’ennui. Penser à tout ce gâchis. «Passer sa jeunesse dans des conditions aussi cruelles, toujours entre la vie et la mort». Le cafard. |
|
16 et 17 |
Dans la Marne |
Soulagement d’être à l’hôpital ou en caserne dans un fort. |
|
18 |
Dans la forêt d'Argonne |
Il reste les os de pauvres gars tombés l’année dernière. Plus d’un s’est fait faucher par surprise. |
|
20 |
Vers la Somme |
15 à 30 km par jour pendant trois semaines avec le barda (p.7 : 30 kg). Passer Noël au front. |
|
22 |
Dans la Somme |
Un froid terrible : le pain et le vin gèlent. 1000 obus par jour. Bombardements aériens. |
|
24 et 25 |
Dans l'Aisne, au Chemin des Dames puis à Craonne |
Une telle boucherie, un tel désastre, c’est inouï. Patauger dans une tranchée pleine de boue. |
|
30 |
En Ariège, à Pau |
Conditions bien meilleures qu’au front. Cafard : Antoinette lui manque. |
|
32 |
Brive |
Nourriture insuffisante. Cafard. Avant de partir pour l’armée d’Orient, les adieux à Antoinette. |
|
36 et 37 |
Tossilovo (près de Salonique et de la Bulgarie) |
Chaleur écrasante, nuit froide, moustiques à fièvre, vipères. Il casse des cailloux. |
|
38 à 40 |
Dans les tranchées en Grèce sur le front bulgare |
«Une vraie vie de forçat !», «Ça barde dur». Il faut travailler la nuit à réparer les lignes téléphoniques. André a perdu toutes ses affaires personnelles. |
|
42 |
En Bulgarie |
Nourriture abondante réquisitionnée en Bulgarie (« nous avons fait comme les Boches en France »). Croix de guerre (« la belle affaire ! »). |
|
44 |
Dans les Balkans, beaucoup de déplacements à travers la Roumanie jusqu’au bord de l’Ukraine |
André embrasse éperdument la photo d'Antoinette, ses cheveux, enragé de se voir impuissant devant son retour. Il faut obéir, sinon c’est la prison. A l’idée de reprendre les armes contre les Russes, les poilus n’arrêtent pas de rouspéter. Hiver rude, 1m50 de neige. |
|
46 |
Sur le chemin du retour depuis la Bessarabie, puis la Bulgarie, etc. |
«Toujours dans des wagons à bestiaux, c’est bien assez bon pour les poilus». |
II-2 – Les soutiens au sein de l’armée
|
Pages |
Lieux |
Exemples d'éléments à relever |
|
10 |
Les Éparges |
S’agripper à la capote d’un ancien. |
|
14 |
En Champagne |
Avec les copains, coudre, boire, jouer aux cartes. |
|
16 |
À l'hôpital de Saint-Dizier puis de Lyon |
Au moins on évite le casse-pipe. «Pour l’instant je suis pépère, je garde un fort.» |
|
22 et 23 |
Dans la Somme |
«Mon régiment a été relevé par les Anglais.» |
II-3 – Les soutiens en dehors de l’armée
|
Pages |
Lieux |
Exemples d'éléments à relever |
|
14 |
Dans sa famille |
Sept jours de permission (sept jours de bonheur) après une hospitalisation. |
|
20 |
Dans la Brie |
Passer voir sa sœur pendant un déplacement de troupes. |
|
24 |
Près de Melun (Ponthierry - Montgermon) |
Une blessure aux jambes : c’est le « filon ». Hospitalisation et convalescence au château de Montgermon. |
|
26 et 27 |
Montgermon |
Marche avec quelques camarades en bord de Seine, rencontre de la « jolie gosse » Antoinette Creuzet, 16 ans. Musique. |
|
28 |
Montgermon |
André fou amoureux parle d’Antoinette. |
|
30 et 31 |
Pau |
Seules les lettres d’Antoinette le font tenir. |
|
32 |
Permission à Paris |
Dernier moment avec Antoinette et sa sœur avant le départ pour la Grèce. |
|
40 |
En Grèce, sur le front bulgare |
«Heureusement j’avais ma Nénette avec moi, mon étoile protectrice. Chaque soir, je contemplais sa charmante photo. Elle me souriait toujours et me redonnait le moral.» |
|
42 et 43 |
En Bulgarie |
Lettre de Nénette, qui lui raconte la fête de l’armistice. |
|
|
|
|
A lire également
|
|
Infirmière pendant la guerre, de Sophie Humann (collection Mon Histoire)
Geneviève Darfeuil a 13 ans au début de la guerre. D’un milieu aisé, elle vit à Paris et passe ses vacances en Normandie. Avec deux frères au front, un père chirurgien à l’arrière et sa lecture des journaux, elle relate de nombreuses nouvelles, tout en manifestant un certain recul vis-à-vis de la propagande. |
Intérêt pédagogique :
L’écriture dynamique, à la fois concrète et sensible, est attachante. On pourra travailler tout particulièrement la façon dont l’auteur montre les sentiments des personnages en décrivant simplement les attitudes. L’attention des élèves sera attirée sur les passages où Geneviève émet des doutes et remarque les impasses dans les informations officielles. Les élèves seront amenés à échanger sur la manière de relater un événement en fonction du destinataire et de l’objectif visé par la communication.